Précisions quant à l’application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme
L’arrêt commenté[1], qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, prend naissance sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air, entre Marseille et Aix-en-Provence
.
La commune de Bouc-Bel-Air a refusé, par un arrêté du 1er octobre 2013, de délivrer un permis de construire, portant sur la création de sept bâtiments comportant quatre-vingts-et-un logements, situés dans le champ de visibilité du jardin d’Albertas dit « jardin d’en haut », classé au titre des monuments historiques.
L’architecte des Bâtiments de France (ABF), saisi en application de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, avait rendu un avis défavorable, lequel plaçait le maire de la commune en situation de compétence liée[2].
Les deux requérantes ont alors saisi le préfet de région d’un recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, en application des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme[3], à propos desquelles le Conseil d’Etat a jugé :
« (…) qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 421-38-4 (devenu l’article R. 424-14) du code de l’urbanisme. (…) »[4].
Le préfet leur a demandé de lui transmettre un dossier complet, ce qu’elles ont fait le 30 décembre 2013. Le préfet, qui disposait d’un délai de deux mois pour se prononcer[5], a confirmé l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, le 28 février 2014. Le maire de la commune a confirmé son refus, par un arrêté du 3 mars 2014.
Les requérantes ont déféré au tribunal administratif de Marseille l’arrêté du 1er octobre 2013 et celui du 3 mars 2014. Le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur le premier et annulé le second.
La commune a alors relevé appel de cette décision. Mais la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête aux motifs que :
- La demande de pièces complémentaires formée par le préfet n’avait pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai d’instruction de deux mois qui lui était imparti, sur le fondement des dispositions de l’article 2 du décret 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui n’est pas applicable, aux termes de l’article 19[6] de cette loi, aux demandes » dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales » tels que les recours administratifs prévus par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
- Le recours des requérantes contre l’avis de l’ABF devait, en conséquence, être regardé comme ayant été admis de sorte qu’elles étaient bénéficiaires d’un permis de construire tacite, dès lors que le maire n’avait pas statué dans le délai d’un mois qui lui était imposé par l’article R. 424-14[7].
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et tranche deux points de droit qui permettent une meilleure lecture de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
- La première question posée au Conseil était de déterminer si le délai de deux mois, imparti au préfet de région pour statuer sur l’avis de l’ABF, ne commençait à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet.
On aurait pu penser, a priori, que ce point n’était pas sujet à controverse. Sans avoir été tranché à propos de l’article R. 424-14, il était possible de s’appuyer sur plusieurs éléments pour y répondre positivement.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de juger, trente ans en arrière, que le délai du déféré préfectoral ne commençait à courir qu’à la date de transmission du texte intégral de l’acte ou des documents annexes sollicités :
« Considérant que, lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est, comme en l’espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le commissaire de la République à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au commissaire de la République par l’article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ; qu’en revanche, à défaut d’un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que l’autorité communale en complète la transmission, présentés par le commissaire de la République dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai imparti au commissaire de la République pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ; (…) »[8].
Sans y voir un principe, on pouvait, au moins intuitivement et logiquement, considérer que la transmission d’un dossier complet est un préalable obligatoire permettant à l’autorité concernée de se prononcer effectivement.
Mais il y avait plus.
La commune appelante invoquait, en effet, le bénéficie de l’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, aujourd’hui à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel :
« Lorsque la demande est incomplète, l’autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ».
Or, la cour ne l’a pas entendu ainsi, au motif que, selon son interprétation, l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 excluait du champ d’application de la loi et, donc, de ses décrets d’application les « demandes dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales ». En d’autres termes, elle a considéré que les articles R. 424-14 et R*. 423-68 constituaient précisément les dispositions spéciales, dont fait état l’article 19 de la loi du 12 avril 2000.
Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit manifeste.
D’une part, l’articles R. 424-14 et R*. 423-68 du code de l’urbanisme ne contiennent aucune disposition spéciale relative à l’accusé de réception d’une demande formée, devant le préfet de région, à l’encontre de l’avis de l’ABF, dès lors que :
- L’article R. 424-14 fixe la procédure encadrant le recours dirigé contre l’avis de l’ABF ;
- L’article R*. 423-68 se borne à prévoir les délais dans lesquels le préfet de région doit se prononcer et les conséquences résultant de son silence
D’autre part, la lecture combinée de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 1er du décret du 6 juin 2001[9] laissent entendre très clairement que la formule rappelée plus bas, selon laquelle l’article 19 ne s’applique pas aux demandes dont l’accusé de réception est régi par des dispositions spéciales, ne vaut que pour les demandes complètes et n’inclut donc pas l’article 2 du décret qui, lui, voit son champ d’application étroitement circonscrit aux demandes incomplètes.
Le Conseil d’Etat a, dans ces conditions, pu juger que :
« (…) lorsqu’un recours formé en application des dispositions qui viennent d’être rappelées contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d’inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu’il fixe, et d’en informer l’autorité d’urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ; que le délai au terme duquel le recours est réputé admis, en vertu de l’article R. 463-68 du code de l’urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises, conformément à l’article 2 du décret du 6 juin 2001, repris à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations ; (…) »[10].
2 Le second point posait la question de la naissance d’un permis tacite après l’intervention du préfet de région.
Poursuivant la logique qu’elle avait jusqu’alors suivie, la cour administrative d’appel a considéré que l’avis du préfet ayant infirmé l’avis de l’ABF, un permis de construire tacite était née, faute pour le maire de la commune de s’être prononcé dans le délai d’un mois, prévu par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Si des règles particulières sont prévues pour la contestation des refus de permis de construire fondés sur l’avis négatif de l’ABF, le code de l’urbanisme prévoit d’autres règles particulières s’agissant de la délivrance des autorisations pour les projets situés dans le champ de visibilité de monuments classés ou inscrits.
On sait ainsi que l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que :
« A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :
- a) (…) ;
- b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.
(…) ».
Il ressort donc de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité compétente sur une demande de permis de construire vaut permis de construire tacite.
Mais cette règle comprend des exceptions notamment dans l’hypothèse où le projet de construction nécessite l’accord de l’ABF.
C’est le sens des dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme qui dispose que :
« Par exception au b de l’article R* 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
Il en est de même, en cas de recours de l’autorité compétente contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours ».
De cet article, il ressort donc que, par exception à l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le silence gardé sur la demande de permis de construire vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’ABF.
Or, en application de l’article R. 425-1, dans sa version applicable aux faits, le permis de construire tenait lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision avait fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet était situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques[11].
Dans son second alinéa, l’article R. 424-3 prévoit le cas particulier du recours formé par l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire contre l’avis défavorable : le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’un mois vaut décision implicite de rejet lorsque, par exemple, le préfet de région a rejeté le recours par une décision expresse
Pour l’application de ces articles, le Conseil d’Etat a précisé que la circonstance que l’ABF n’avait pas transmis son avis au demandeur d’un permis de construire alors qu’il était tenu de le faire ne faisait pas naître un permis tacite :
« (…) il résulte de ces dispositions que s’il incombe à l’architecte des Bâtiments de France d’adresser au demandeur d’un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d’informer alors le demandeur qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l’information du demandeur, ne peut avoir pour effet l’acquisition d’un permis tacite ; qu’au demeurant, lorsqu’il n’a pas reçu copie de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le demandeur, qui a été informé de ce que le délai d’instruction était allongé en raison de la nécessité de recueillir l’avis favorable de cette autorité, a la faculté de se renseigner, auprès du service instructeur, sur le sens de l’avis rendu ; que, dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France avait omis d’adresser à la requérante copie de son avis favorable assorti de prescriptions n’avait pu avoir pour effet de faire naître un permis tacite ; (…) »[12].
Est-ce à dire qu’aucun permis de construire tacite ne puisse naître dès lors que l’immeuble se trouve dans le champ de visibilité d’un monument historique ou dans ses abords, pour reprendre la nouvelle terminologie de l’article R. 425-1 ?
Telle n’est pas la position du Conseil d’Etat qui opère une distinction selon que le préfet a ou non infirmé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
« (…) l’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France ; que, lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé ; que lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis de l’architecte de Bâtiments de France ; que si l’autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé ; (…) ».
De ce considérant, deux enseignements doivent être retenus lorsque le préfet de région ou le ministre, en cas d’évocation, confirme l’avis défavorable de l’ABF :
- Dans cette hypothèse, aucun permis de construire tacite ne peut naître. L’autorité compétente n’est d’ailleurs pas tenue de se prononcer une nouvelle fois sur la demande. Quand bien même, elle le ferait sa décision serait purement confirmative et donc insusceptible de recours[13].
- Le délai de recours dirigé contre le refus de permis de construire n’obéit plus aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, puisqu’il commence à courir à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis de l’ABF.
[1] CE 4 mai 2018 Commune de Bouc-Bel-Air, req. n° 410790 : décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon.
[2] CE 22 février 1957 Société coopérative de reconstruction de Rouen et de sa région « Reconstruire », req. n° 17140 : décision publiée au recueil Lebon, p. 123, et CE 27 juillet 1988 Durand, req. n° 74681.
[3] « (…) le demandeur peut, en cas (…) de refus de permis fondé sur une opposition de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l’autorité compétente en matière de permis. / Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l’article R.* 423-68 et celles de l’article R.* 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. / Si le préfet de région (…) infirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l’admission tacite du recours ».
[4] CE avis 30 juin 2010 Société à responsabilité limité Château d’Epinay, req. n° 334747 : décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon. Voyez, également, CE 12 février SNC Siber, req. n° 359343 : décision publiée au recueil Lebon ; conclusions Maud Vialettes, BJDU n° 2/2014, p. 139.
[5] Aux termes de l’article R.* 423-68, dans sa version issue du décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 applicables aux faits : « Le délai à l’issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l’autorité compétente contre l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France est, en l’absence d’évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés :
(…) ;
- c) De deux mois lorsque l’avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du patrimoine.
En l’absence de décision expresse du préfet de région à l’issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis.
(…) ».
[6] C’est une erreur de plume qui conduit la cour à mentionner l’article 18 de la loi du 12 avril 2000.
[7] CAA Marseille 23 mars 2017 Commune de Bouc-Bel-Air, req. n° 15MA00964.
[8] CE Section 13 janvier 1988, req. n° 68166 : décision publiée au recueil Lebon.
[9] « L’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : (…) ».
[10] CE 4 mai 2018 Commune de Bouc-Bel-Air, précité.
[11] L’article R. 425-1, issu du décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables prend acte de la loi prend acte de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création à l’architecture et au patrimoine, laquelle a réécrit le titre II du livre VI du code du patrimoine et, notamment, les articles L. 621-30 à L. 621-32.
L’accord de l’ABF est toujours exigé.
Le « champ de visibilité » se voit désormais substitué « les abords des monuments historiques ». Un périmètre de protection des abords de monuments historique, qui reste une servitude d’utilité publique, est désormais déterminé de façon propre à chaque monument selon une procédure unique, définie aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine.
Les périmètres anciennement institués sur le fondement des alinéa 5 et 6 de l’article L. 621-30 deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords, au sens des nouvelles dispositions de la loi. En l’absence d’une délimitation propre, l’article L. 621-30 conserve le régime antérieur, à savoir que la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
[12] CE 29 mars 2017 SCI Maryse, req. n° 392940.
[13] CE 28 février 1973 Epoux Teyssedre, req. n° 74890 : décision publiée au recueil Lebon.
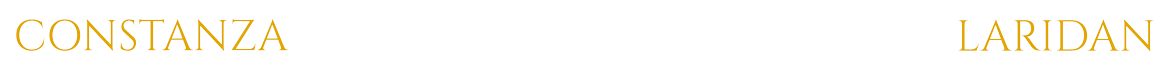
Laisser un commentaire